ZAN : quels sont les enjeux de la loi TRACE ?
SOMMAIRE
- D'où vient le ZAN ? Genèse et grands principes
- Qu'entend-on par "artificialiser" ?
- Une déclinaison dans les documents d'urbanisme
- Loi TRACE : ou comment assouplir le ZAN
- Objectif 2050 maintenu, jalon 2031 effacé
- Calendrier repoussé à 2027 pour les documents d'urbanisme
- Soulagement des élus, colère des ONG
- Les enjeux environnementaux au cœur du ZAN
- Biodiversité : le prix des parcelles perdues
- Des sols moins efficaces pour stocker le carbone... et pour gérer l'eau
- Terres agricoles : enjeu de souveraineté alimentaire
- Résilience urbaine : fraîcheur et infiltration
- Relancer l'industrie tout en logeant les Français
- Réindustraliser sans déborder
- Loger plus de monde... sans étaler la ville
- Un coût supplémentaire pour les collectivités
- Agriculteurs et foncier rural en première ligne
- Qui pousse, qui freine ? Le jeu d'acteurs autour de la loi TRACE et du ZAN
- Collectivités et acteurs économiques : un soulagement prudent
- Promoteurs, industriels et chambres consulaires : l'occasion de relancer les projets
- Les défis de la mise en œuvre
- Suivre la consommation foncière et mobiliser les compétences
- Financer le recyclage plutôt que l'étalement
- Densifier sans sacrifier la qualité de vie et coordonner les politiques publiques
C'est désormais officiel : le Sénat a adopté, le 18 mars 2025, la proposition de loi TRACE ("Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus"), premier pas d'un texte qui doit encore être examiné par l'Assemblée nationale. Portée par les sénateurs Guislain Cambier et Jean-Baptiste Blanc, cette initiative vise à "réajuster" la mise en œuvre du zéro artificialisation nette (ZAN) en tenant compte des remontées de terrain des collectivités locales.
Pour rappel, la loi Climat-Résilience d'août 2021 a gravé deux caps : diviser par deux la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031, puis atteindre le ZAN en 2050. C'est cette trajectoire, jugée trop rigide par de nombreux élus, que TRACE entend assouplir sans renoncer à l'objectif final.
Derrière le bras de fer législatif se cache un dilemme devenu omniprésent dans l'aménagement du territoire : comment loger, produire l'économie sans bétonner davantage ? La proposition de loi TRACE relance le débat : pour les uns, elle offre une bouffée d'oxygène aux maires qui peinent à adapter leurs documents d'urbanisme ; pour les autres, elle risque d'éroder un cap écologique difficile à tenir.
IMMO9, votre spécialiste de l'immobilier neuf à Bordeaux décrypte pour vous les enjeux de la proposition de loi.
D'où vient le ZAN ? Genèse et grands principes
Adoptée le 22 août 2021, la loi Climat-Résilience fixe pour la première fois un cap clair : parvenir à zéro artificialisation nette des sols en 2050. Elle prévoit aussi une étape intermédiaire décisive : réduire de 50 % le rythme de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.
Constatant les difficultés des collectivités à décliner la trajectoire, le Parlement vote, le 20 juillet 2023, une loi dite "ZAN" qui assouplit les calendriers, renforce l'accompagnement technique et introduit des dérogations ponctuelles pour certains projets d'intérêt national. L'objectif 2050 demeure, mais la mise en œuvre se veut plus graduelle et concertée.
Concrètement, les territoires devront diviser par deux leurs hectares artificialisés sur la décennie 2021-2031, avant de tendre vers zéro sol artificialisé net vingt ans plus tard. Le suivi repose sur les bases foncières de l'IGN et de la DGFiP, retravaillées par le Cerema pour produire un chiffre annuel de "consommation" d'ENAF.
Qu'entend-on par "artificialiser" ?
La loi qualifie d'artificialisé tout sol dont les fonctions écologiques, biologiques, hydriques, climatiques et agronomiques ont été durablement altérées, qu'il s'agisse d'un parking, d'une zone d'activité ou d'un lotissement. Inversement, la renaturation consiste à rendre au sol un état non artificialisé. Les surfaces prises en compte sont regroupées sous l'acronyme ENAF.
Une déclinaison dans les documents d'urbanisme
Pour traduire l'objectif dans l'aménagement quotidien, la trajectoire ZAN doit être inscrite successivement dans les SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires), les SCoT (Schéma de cohérence territoriale) puis les PLU(i) (Plan Local d'Urbanisme intercommunal). Ces documents doivent déterminer des quotas annuels de "droits à consommer" et identifier les friches à réutiliser, l'État ayant fixé un horizon, désormais repoussé à 2027, pour cette mise en comptabilité.
Au-delà des chiffres, le ZAN marque donc un changement de paradigme : construire ou produire d'abord sur l'existant, et considérer le foncier comme une ressource finie à ménager plutôt qu'un gisement inépuisable.
Loi TRACE : ou comment assouplir le ZAN

Déposée au Sénat en novembre 2024 par les centristes Guislain Cambier et Jean-Baptiste Blanc, la proposition de loi TRACE répond aux multiples déconvenues rencontrées par les mairies et les départements : quotas intenables, méthodes de calcul trop complexes, et risque de blocage sur l'offre de logement comme sur l'implantation d'entreprises.
Objectif 2050 maintenu, jalon 2031 effacé
Le texte confirme la cible "zéro artificialisation nette" en 2050, mais supprime le seuil national de 50 % à l'horizon 2031. À la place, chaque région recevra un objectif intermédiaire "sur mesure", fixé par arrêté préfectoral après concertation avec les élus. Les auteurs estiment qu'une trajectoire différenciée reflètera mieux la diversité des besoins territoriaux.
TRACE rebat aussi les cartes techniques : la réduction ne sera plus calculée sur la notion d'"artificialisation" au sens large, mais uniquement sur la consommation d'ENAF (espaces naturels, agricoles et forestiers). Les sénateurs jugent la définition plus lisible pour les collectivités ; les ONG, elles, dénoncent un indicateur "à la carte" qui risque de sous-estimer l'impact réel.
Pour éviter que les grandes infrastructures n'engloutissent les quotas régionaux, le texte créé une réserve nationale de 10 000 ha qui ne seront pas imputés aux territoires hôtes. De quoi, selon les rapporteurs "sécuriser la réindustrialisation" sans pénaliser les bilans locaux et ouvrir une brèche de plus dans le ZAN, rétorquent les écologistes.
Calendrier repoussé à 2027 pour les documents d'urbanisme
SRADDET, SCoT et PLU(i) devaient initialement intégrer les plafonds avant fin 2025. TRACE accorde deux ans supplémentaires (jusqu'en 2027) pour boucler ces mises à jour, le Sénat soulignant la "course contre la montre" à laquelle sont confrontées les petites collectivités.
Le texte institue des conférences régionales de sobriété foncière dotées d'un pouvoir de proposition sur la répartition des quotas et l'arbitrage des projets. Objectif : sortir d'une logique "descendante" et ancrer le pilotage du ZAN dans les territoires.
Soulagement des élus, colère des ONG
Les associations d'élus saluent une "bouffée d'oxygène" : elles y voient la possibilité de poursuivre des opérations d'habitat ou d'activité sans se heurter à un mur réglementaire. À l'inverse, les organisations environnementales comme la Fondation pour la Nature et l'Homme en tête, dénoncent un "permis de bétonner" qui diluerait l'effort collectif et reporterait les difficultés sur la prochaine décennie.
Les enjeux environnementaux au cœur du ZAN

Biodiversité : le prix des parcelles perdues
Chaque fois qu'un hectare d'herbage ou de forêt cède la place à un lotissement ou un parking, l'habitat des espèces est morcelé : la continuité écologique qui permet aux animaux de circuler et aux plantes de se disséminer se brise. Le ministère de la Transition écologique alerte : la fragmentation est l'un des premiers moteurs de l'érosion de la biodiversité en France, accélérant la disparition d'espaces déjà sous pression. À l'échelle nationale, 20 000 à 30 000 ha d'espaces naturels, agricoles ou forestiers disparaissent encore chaque année selon Vie-publique.fr.
Des sols moins efficaces pour stocker le carbone... et pour gérer l'eau
Les sols jouent un double rôle : puits de CO₂ et éponge naturelle. Les imperméabiliser réduit leur capacité à séquestrer le carbone et aggrave le ruissellement. Un décryptage du cabinet de conseil Carbone 4 rappelle qu'en compromettant ces "puits", on complique l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Les épisodes de pluies intenses, de plus en plus fréquentes, se transforment alors en inondations éclair, faute de sols capables d'absorber l'eau.
Terres agricoles : enjeu de souveraineté alimentaire
Dans un contexte de tensions géopolitiques, la France s'est dotée d'une loi "Souveraineté agricole" en mars 2025. Or, la SAU (surface agricole utile) perd encore du terrain sous la poussée urbaine. Pour la FN Safer comme pour les Chambres d'agriculture, stabiliser, voire reconquérir ces surfaces est un préalable à l'indépendance alimentaire et à la préservation des paysages ruraux.
Résilience urbaine : fraîcheur et infiltration
Villes et métropoles cherchent désormais à "désimperméabiliser" cours d'école et parkings, à grands coups de revêtements perméables et de plantations. Cette renaturation réduit les îlots de chaleur tout en favorisant l'infiltration des eaux pluviales, deux fonctions vitales dans un climat qui se réchauffe.
La trajectoire ZAN concentre ainsi quatre combats majeurs : biodiversité, climat, alimentation et résilience, qu'aucun territoire ne peut se permettre de dissocier : c'est tout l'enjeu de fixer, puis de tenir, une limite claire à l'artificialisation des sols.
Relancer l'industrie tout en logeant les Français

Le terrain se fait rare : les hectares disponibles doivent désormais se partager entre usines de batteries, logements attendus et exploitations agricoles. Or le sol n’est pas extensible ; chaque choix foncier pèse à la fois sur l’emploi, le pouvoir d’achat des ménages et la souveraineté alimentaire.
Réindustraliser sans déborder
La France a mis de côté une enveloppe foncière de 12 500 hectares pour attirer les méga-usines et autres projets dits "stratégiques" ; ces terrains sont retranchés du calcul ZAN afin d'éviter que la politique de sobriété ne torpille la relance industrielle. Or, selon Le Monde, près de 11 900 ha sont déjà fléchés, et Bercy pousse pour élargir encore la réserve, au grand dam du ministère chargé de l'écologie et des ONG, qui redoute un précédent "permis de bétonner".
Loger plus de monde... sans étaler la ville
Sur le front du logement, la partie est toute aussi serrée : le gouvernement compte sur la "densification douce" (surélévations, division de parcelles, reconversion de friches) pour répondre à la pénurie résidentielle sans empiéter sur les terres agricoles. Une note du réseau RésiZAN et un projet de loi porté par Gabriel Attal veulent faciliter la construction de petites unités dans les zones pavillonnaires, mais les maires restent frileux face aux craintes de leurs administrés.
Un coût supplémentaire pour les collectivités
Pour recycler une friche ou renaturer un parking, il faut des études, des travaux... et des moyens. Une étude de la Banque des Territoires chiffre les besoins à 650-850 millions d'euros par an rien que pour le recyclage des friches, très au-dessus des dotations actuelles du Fonds vert. À cela s'ajoute la pénurie d'ingénieurs spécialisés et le casse-tête des données foncières, que nombre de petites communes peinent encore à exploiter.
Agriculteurs et foncier rural en première ligne
Chaque hectare grignoté, c'est un bout de souveraineté alimentaire qui s'en va : les Chambres d'agriculture rappellent que la perte annuelle de surface agricole équivaut à l'alimentation de près de 200 000 personnes. En parallèle, la perspective de futures restrictions alimente la spéculation : le prix des petits terrains constructibles a encore progressé de 6,3 % en zone rurale, selon une enquête foncière de la FN Safer, accentuant la pression sur les exploitants.
Qui pousse, qui freine ? Le jeu d'acteurs autour de la loi TRACE et du ZAN
Dans un communiqué publié le jour même de l'adoption au Sénat, le ministère de la Transition écologique met en avant une ligne de crête : préserver l'objectif ZAN 2050 tout en offrant "des marges de manœuvre réalistes" aux territoires. Le gouvernement a même enclenché la procédure accélérée du texte, signe qu'il souhaite clore rapidement le débat parlementaire.
Collectivités et acteurs économiques : un soulagement prudent
Du côté des élus, l'Association des petites villes de France (APVF) y voit un "bol d'oxygène" : la suppression du jalon de –50 % à l'horizon 2031, combinée à une réserve nationale de 10 000 ha pour les grands projets, éviterait selon elle de gripper la production de logements.
Elle réclame toutefois un fonds pérenne pour financer la reconversion de friches. Les chambres consulaires et la Fédération française du bâtiment voient également dans TRACE la possibilité de relancer les permis de construire en chute libre ; la FBB estime que l'assouplissement "sécurise enfin la visibilité foncière" nécessaire à la reprise d'activité prévue pour 2025.
Promoteurs, industriels et chambres consulaires : l'occasion de relancer les projets
Les fédérations du bâtiment et les promoteurs immobiliers voient cet assouplissement comme une bouffée d'air pour un secteur en crise : simplification des normes, meilleure visibilité sur les réserves foncières et possibilité d'intégrer plus facilement les grands projets industriels ou de logement. Le secteur immobilier espère ainsi enrayer la chute des permis de construire.
Les défis de la mise en œuvre

Avant de viser le zéro artificialisation nette, encore faut-il savoir où l’on construit, avec quelles compétences et quels budgets. Données vieillissantes, financement du recyclage foncier, acceptation des habitants : trois angles morts qui peuvent faire dérailler la trajectoire ZAN si rien n’est anticipé.
Suivre la consommation foncière et mobiliser les compétences
Le premier obstacle reste la donnée : les bases cadastrales et clichés aériens accusent souvent deux ou trois ans de retard, ce qui rend le pilotage quasi aveugle. Mettre à jour ces cartographies au rythme d'un budget annuel supposerait un "guiche technique" capable d'accompagner surtout les petites communes, dépourvues d'experts SIG, d'écologues ou de juristes. Sans cette ingénierie mutualisée, la trajectoire restera théorique.
Financer le recyclage plutôt que l'étalement
Réhabiliter une friche industrielle ou dépolluer un ancien dépôt coûte jusqu'à cinq fois plus cher que d'ouvrir un champ à l'urbanisation. Le Fonds vert et le fonds friches, même dopés, ne couvrent qu'une fraction de la facture. Les élus demandent donc un financement pérenne et un système de péréquation pour que la "ville sur la ville" devienne la norme et pas l'exception.
Densifier sans sacrifier la qualité de vie et coordonner les politiques publiques
Répondre à la pénurie de logements passera par des surélévations, des divisions de parcelles et des opérations de renouvellement urbain. Or les habitants redoutent un "béton vertical" qui rognerait jardins, vues et fraîcheur. La réussite dépendra autant d'une architecture soignée et d'espaces verts de proximité que d'un discours transparent sur les bénéfices collectifs.
Parallèlement, l'État devra trancher entre les méga-usines de batteries, les grands chantiers de la transition énergétique et les programmes de logement : trois politiques sectorielles qui se disputent souvent la même parcelle de terrain. Des incitations positives (bonus financiers pour les territoires vertueux, dotations majorées) pourraient compléter le volet sanction prévu en cas de dépassement des plafonds.
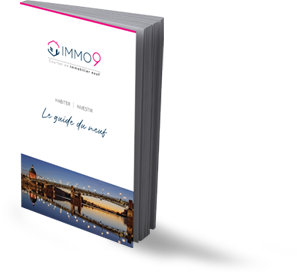

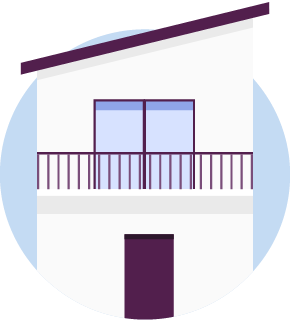
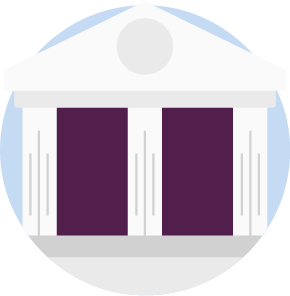





 Sophie Castella
Sophie Castella












Commentaires à propos de cet article :
Ajouter un commentaire